Arbre généalogique des familles Rousseau et Bernard.
Présentation de la famille de Jean Jacques Rousseau.
Le père :
Jean Jacques Rousseau est né à Genève en 1712 dans une famille protestante française. Son père, Isaac Rousseau, est artisan horloger et citoyen de Genève (il a le droit d’entrer au Conseil Général détenant le pouvoir législatif). Il vit avec sa femme Suzanne Bernard un amour tendre et sincère jusqu’à ce qu’elle meure à la naissance de Jean Jacques Rousseau.
Rousseau vit donc avec son père jusqu’à l’âge de 11 ans ; après, il partira chez son oncle Bernard, son père ayant été expulsé de Genève pour une histoire de vengeance entre M Gautier, capitaine de France, et lui. Rousseau, une fois adulte, ne verra son père que lors de rares visites entre deux voyages à pied.
La mère :
Suzanne Bernard, fille du ministre Bernard selon Jean Jacques Rousseau, mais elle est en fait la nièce du pasteur Bernard. Elle possède une assez modeste richesse. Elle meurt à la naissance de Jean Jacques Rousseau. Ce dernier ne la connaîtra donc pas.
Gabriel Bernard ou oncle Bernard :
C’est le frère de la mère de Jean Jacques Rousseau. Il se mariera avec une des sœurs du père de Jean Jacques Rousseau : la tante Bernard. C’est un ingénieur qui prendra soin de Jean Jacques Rousseau à partir de l’âge de 11 ans. Il l’enverra en pension à Bossey avec son cousin, puis il lui fera faire un apprentissage. Jean Jacques Rousseau le qualifie comme « un homme de plaisir ».
Son cousin :
Il est du même âge que lui et Rousseau passera avec son cousin une bonne partie de sa jeunesse à Bossey et en apprentissage. Après la fuite de son lieu d’apprentissage, Jean Jacques Rousseau ne verra plus jamais son cousin.
Tante Suzanne :
C’est une des sœurs de son père qui s’occupera beaucoup de Jean Jacques Rousseau et suscitera chez lui le goût pour la musique.
Son frère :
Il est plus âgé que lui de sept ans. Il a suivi un apprentissage d’horloger (comme son père). Il est négligé par rapport à Jean Jacques Rousseau. Ce dernier n’a pas beaucoup de rapports avec lui, ne le connaît pas trop, cependant il l’aime. Ce frère connaît le libertinage et s’enfuit en Allemagne. Jean Jacques Rousseau ne le reverra jamais.
La mie Jacqueline :
Domestique qui était là durant toute la jeunesse de Rousseau. Elle symbolise la gentillesse et l’amour donnés.
Belle-mère :
C’est la seconde femme de son père. Rousseau ne semble pas l’apprécier. Il la trouve hypocrite.
Mme de Warens :
C’est l’éducatrice à tous les niveaux de la vie. Elle s’occupe de Rousseau à partir de 16 ans ; ce dernier tombe directement sous son charme et la considérera toute sa vie comme sa seconde mère.
Tout au long de sa vie, Jean Jacques éprouva un manque affectif, ayant perdu sa mère, et il tenta de la retrouver auprès de différentes personnes.
Mais il ne faut pas oublier que même s’il n’a pas beaucoup de rapports avec sa famille, il lui rend hommage constamment :
« comment serais-je devenu méchant quand je n’avais sous les yeux que des exemples de douceur et autour de moi que les meilleures gens du monde ».
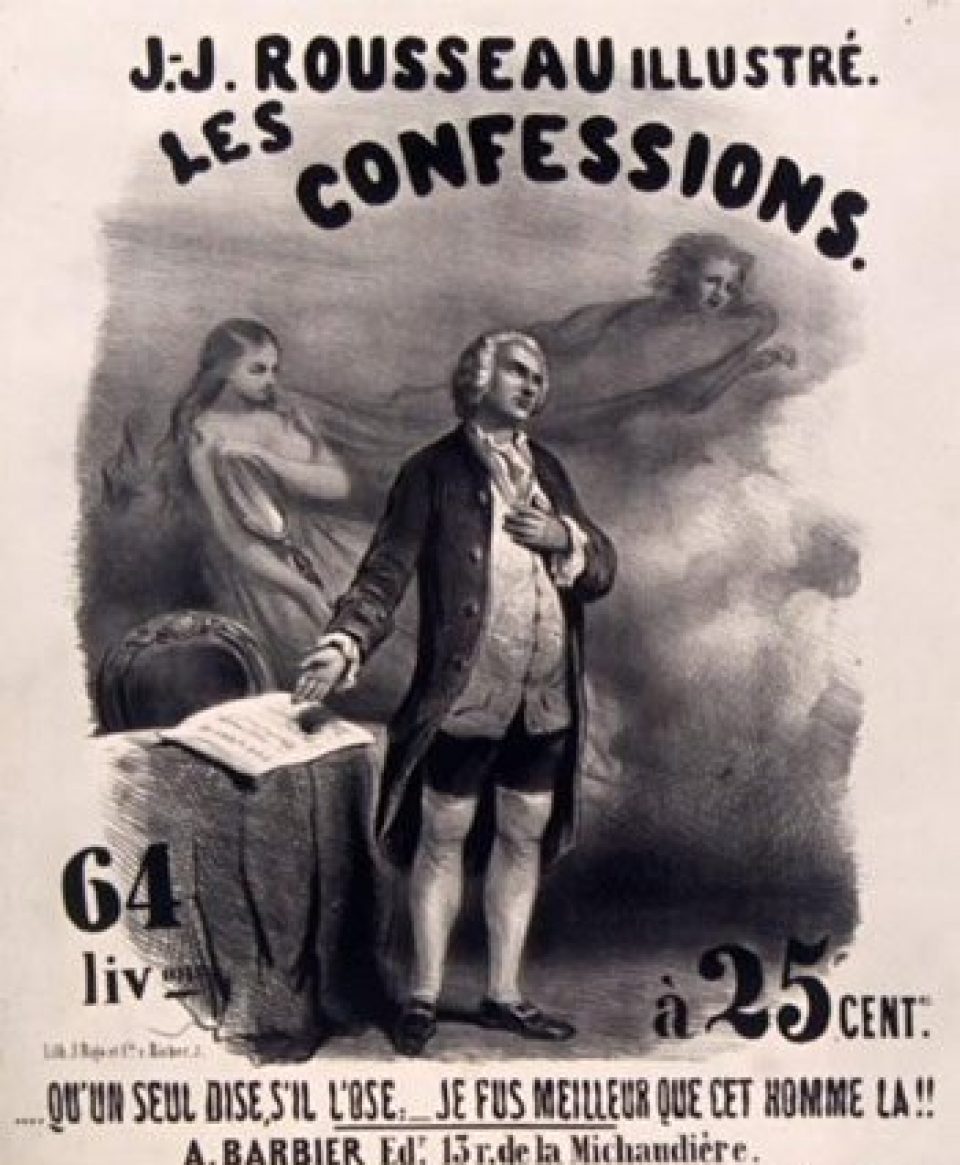

J’aimerai connaîtres le prénom des cinq enfants de Rousseau
Voici en quelques mots la réponse :
Jean-Jacques Rousseau, Lettre à Madame de Francueil, 1751
J.-J. Rousseau a confié ses cinq enfants aux Enfants-Trouvés, organisme qui correspond aujourd’hui à l’assistance publique. Il a été pour cela l’objet de multiples attaques.
À Madame de Francueil, À Paris, le 20 avril 1751
Oui, madame, j’ai mis mes enfants aux Enfants-Trouvés; j’ai chargé de leur entretien l’établissement fait pour cela. Si ma misère et mes maux m’ôtent le pouvoir de remplir un soin si cher, c’est un malheur dont il faut me plaindre, et non un crime à me reprocher. Je leur dois la subsistance, je la leur ai procurée meilleure ou plus sûre au moins que je n’aurais pu la leur donner moi-même; cet article est avant tout1. Ensuite, vient la déclaration de leur mère2 qu’il ne faut pas déshonorer.
Vous connaissez ma situation, je gagne au jour la journée mon pain avec assez de peine; comment nourrirais-je encore une famille? Et si j’étais contraint de recourir au métier d’auteur, comment les soucis domestiques et les tracas des enfants me laisseraient-ils, dans mon grenier, la tranquillité d’esprit nécessaire pour faire un travail lucratif? Les écrits que dicte la faim ne rapportent guère et cette ressource est bientôt épuisée. Il faudrait donc recourir aux protections, à l’intrigue, au manège, briguer quelque vil emploi; le faire valoir par les moyens ordinaires, autrement il ne me nourrira pas, et me sera bientôt ôté; enfin, me livrer moi-même à toutes les infamies pour lesquelles je suis pénétré d’une si juste horreur. Nourrir, moi, mes enfants et leur mère, du sang des misérables! Non, madame, il vaut mieux qu’ils soient orphelins que d’avoir pour père un fripon.
Accablé d’une maladie douloureuse et mortelle, je ne puis espérer encore une longue vie; quand je pourrais entretenir, de mon vivant, ces infortunés destinés à souffrir un jour, ils payeraient chèrement l’avantage d’avoir été tenus un peu plus délicatement qu’ils ne pourront l’être où ils sont. Leur mère, victime de mon zèle indiscret, chargée de sa propre honte et de ses propres besoins, presque aussi valétudinaire3, et encore moins en état de les nourrir que moi, sera forcée de les abandonner à eux-mêmes, et je ne vois pour eux que l’alternative de se faire décrotteurs ou bandits, ce qui revient bientôt au même. Si du moins leur état était légitime, ils pourraient trouver plus aisément des ressources. Ayant à porter à la fois le déshonneur de leur naissance et celui de leur misère, que deviendront-ils?
Que ne me suis-je marié, me direz-vous? Demandez à vos injustes lois, madame. Il ne me convenait pas de contracter un engagement éternel, et jamais on ne me prouvera qu’aucun devoir m’y oblige. Ce qu’il y a de certain, c’est que je n’en ai rien fait, et que je n’en veux rien faire. « Il ne faut pas faire des enfants quand on ne peut pas les nourrir. » Pardonnez-moi, madame, la nature veut qu’on en fasse puisque la terre produit de quoi nourrir tout le monde; mais c’est l’état des riches, c’est votre état qui vole au mien le pain de mes enfants. La nature veut aussi qu’on pourvoie à leur subsistance; voilà ce que j’ai fait; s’il n’existait pas pour eux un asile, je ferais mon devoir et me résoudrais à mourir de faim moi-même plutôt que de ne pas les nourrir. Ce mot d’Enfants-Trouvés vous en imposerait-il, comme si l’on trouvait ces enfants dans les rues, exposés à périr si le hasard ne les sauve? Soyez sûre que vous n’auriez pas plus d’horreur que moi pour l’indigne père qui pourrait se résoudre à cette barbarie: elle est trop loin de mon cœur pour que je daigne m’en justifier. Il y a des règles établies; informez-vous de ce qu’elles sont, et vous saurez que les enfants ne sortent des mains de la sage-femme que pour passer dans celles d’une nourrice. Je sais que ces enfants ne sont pas élevés délicatement: tant mieux pour eux, ils en deviennent plus robustes; on ne leur donne rien de superflu, mais ils ont le nécessaire; on n’en fait pas des messieurs, mais des paysans ou des ouvriers. Je ne vois rien, dans cette manière de les élever, dont je ne fisse choix pour les miens. Quand j’en serais le maître, je ne les préparerais point, par la mollesse, aux maladies que donnent la fatigue et les intempéries de l’air à ceux qui n’y sont pas faits. Ils ne sauraient ni danser, ni monter à cheval; mais ils auraient de bonnes jambes infatigables. Je n’en ferais ni des auteurs ni des gens de bureau; je ne les exercerais point à manier la plume, mais la charrue, la lime ou le rabot, instruments qui font mener une vie saine, laborieuse, innocente, dont on n’abuse jamais pour mal faire, et qui n’attire point d’ennemis en faisant bien. C’est à cela qu’ils sont destinés; par la rustique éducation qu’on leur donne, ils seront plus heureux que leur père. »